Alzheimer : feu rouge au lecanemab en accès précoce
Le 9 septembre, la HAS a tranché : pas d’accès précoce pour le lecanemab (Leqembi®), anticorps monoclonal développé par Biogen et Eisai. Cette procédure aurait permis une mise à disposition rapide et transitoire, en attendant une autorisation de droit commun. Pour l’instant, les patients français ne pourront donc pas en bénéficier, alors même que l’Union européenne a délivré une AMM restreinte quelques mois plus tôt.
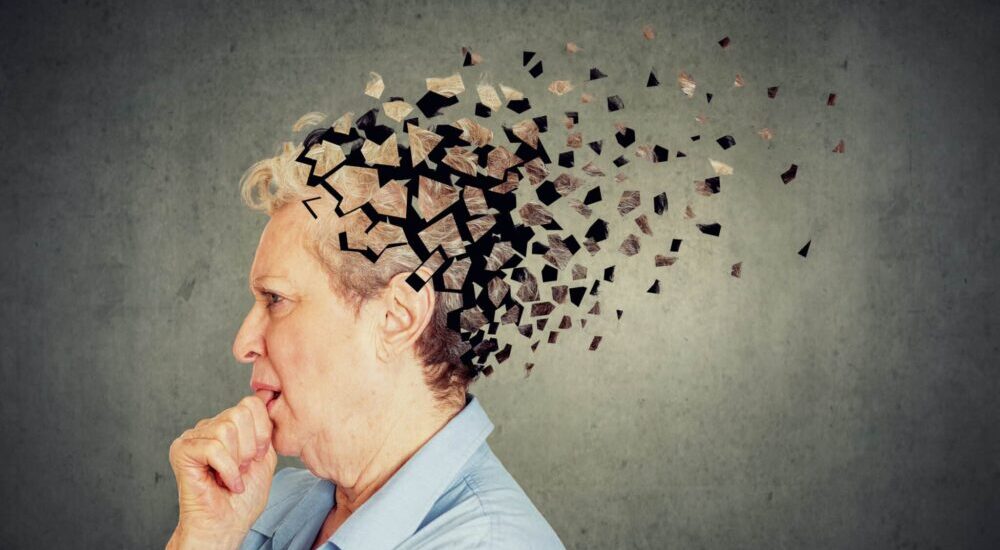
Une efficacité jugée limitée
Les données cliniques issues de l’essai pivot montrent une réduction du déclin cognitif d’environ 27 % à 18 mois, mais ce chiffre correspond en pratique à un simple décalage de quelques mois dans la progression de la maladie. Pour la HAS, ce gain reste trop faible au regard de l’histoire naturelle d’Alzheimer, pathologie qui s’étend sur une décennie ou plus. L’agence insiste également sur l’absence de preuve solide reliant la réduction des dépôts amyloïdes à une amélioration clinique durable.
Des risques bien réels
La tolérance constitue le principal point noir. Près d’un patient sur six présente une hémorragie cérébrale détectée à l’IRM, et plus d’un sur dix un œdème cérébral. Ces « anomalies liées aux amyloïdes » (ARIA) sont d’autant plus fréquentes chez les porteurs du gène APOE4, facteur de risque génétique de la maladie. Pour limiter les accidents, l’utilisation du médicament serait réservée aux patients non porteurs ou hétérozygotes, assortie d’un suivi par IRM répété – une contrainte logistique considérable.
Un traitement difficile à mettre en œuvre
Outre la sélection génétique des patients, le protocole impose une IRM avant l’initiation puis avant certaines perfusions clés. La prise en charge ne peut donc se concevoir que dans des centres hospitaliers spécialisés disposant d’un plateau technique lourd et d’équipes formées. Pour la HAS, cette mise en œuvre apparaît peu compatible avec une diffusion large, au regard du nombre de patients concernés.
Le coût, un paramètre sensible
Même si la HAS ne le mentionne pas explicitement, l’argument économique pèse en arrière-plan. Aux États-Unis, le prix annuel est fixé à environ 26 500 dollars, sans compter les examens d’imagerie et de biologie nécessaires au suivi. Transposé à plus d’un million de personnes atteintes d’Alzheimer en France, l’impact financier serait considérable pour l’Assurance Maladie.
Patients et associations déçus
Pour les associations, c’est une décision frustrante. Le lecanemab représentait le premier traitement ayant montré un ralentissement, même modeste, de la maladie. Elles craignent surtout que le temps perdu prive certains patients de l’éligibilité au moment où une autorisation de droit commun, plus longue à obtenir, pourrait aboutir.
Et après ?
Le laboratoire a déjà déposé une demande d’autorisation classique. Cette procédure implique une évaluation du service médical rendu, la fixation d’un prix et des négociations parfois longues. En moyenne, il faut compter 18 mois. Pour une maladie évolutive comme Alzheimer, chaque mois compte : les patients au stade débutant aujourd’hui pourraient avoir dépassé la fenêtre thérapeutique lorsque le traitement deviendra disponible.
 Se connecter
Se connecter

