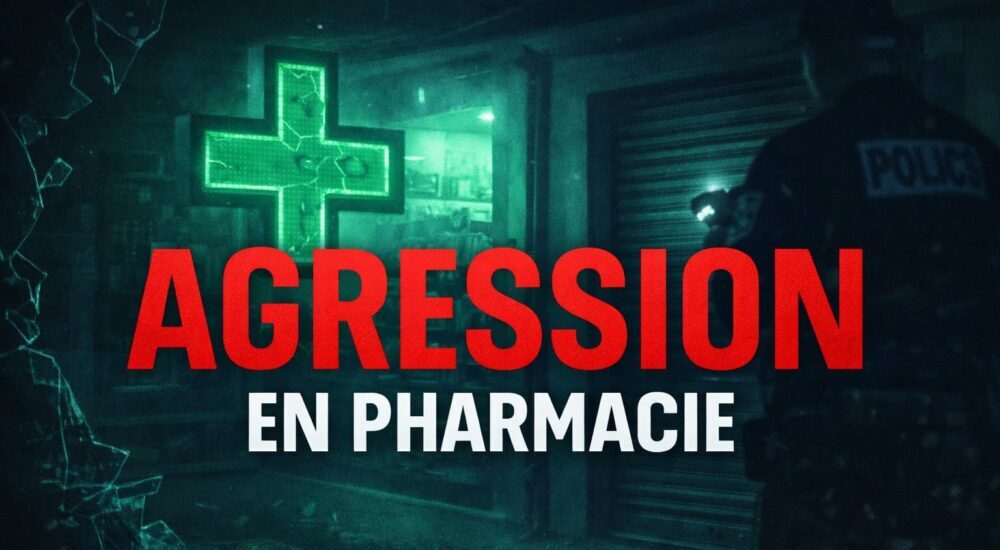Doliprane : le cachet préféré des Français est-il américain ?
Le géant Sanofi a cédé 50 % de sa filiale qui fabrique le Doliprane à un fonds américain. Rupture de souveraineté, menace sur la production, perte de contrôle français ? Derrière les gros titres, la réalité est bien plus complexe - et beaucoup plus stratégique. Enquête dans les coulisses d’un médicament pas comme les autres.
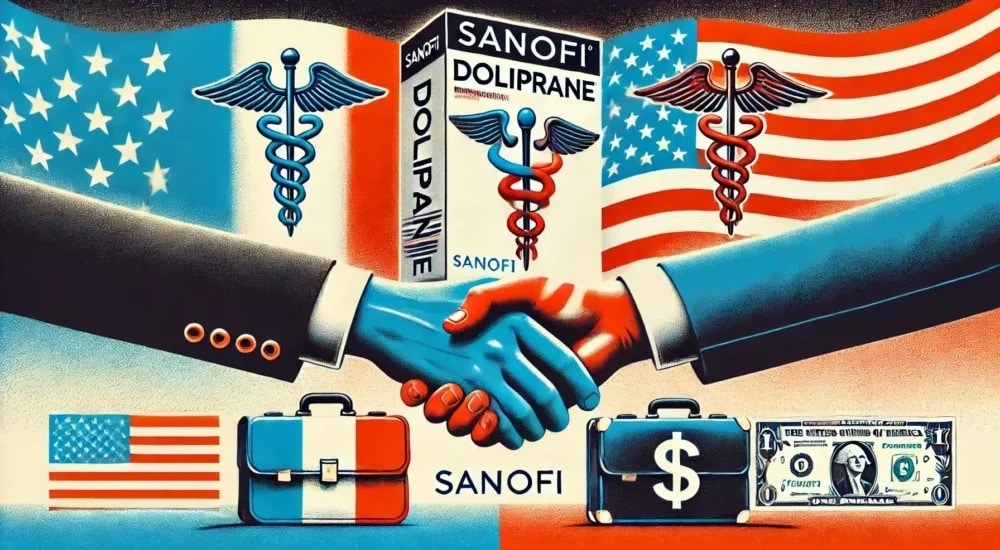
Une cession stratégique, mais encadrée
Le 30 avril 2025, Sanofi a annoncé la finalisation de la vente de 50 % du capital de sa filiale Opella Healthcare au fonds d’investissement américain Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), pour une valorisation globale de près de 10 milliards d’euros. Opella, qui regroupe l’ensemble des marques de santé grand public du laboratoire — dont la plus emblématique est Doliprane — devient ainsi une coentreprise à gouvernance partagée. Loin d’un désengagement total, Sanofi conserve 48,2 % du capital et l’État, via Bpifrance, en détient 1,8 %. Cette transaction s’inscrit dans une stratégie globale de réorientation vers les médicaments de spécialité et les biotechnologies. Elle ne marque pas une rupture, mais bien une évolution du modèle de développement pharmaceutique en France.
Doliprane, produit symbolique et pilier sanitaire
Médicament phare de l’automédication en France, Doliprane est bien plus qu’un simple antalgique. Avec près de 300 millions de boîtes vendues chaque année, il constitue l’un des produits de santé les plus diffusés et les plus utilisés par les Français. Prescrit chez le nourrisson comme chez le senior, il est le premier recours contre la douleur et la fièvre. Depuis ses débuts, il est produit en France, sur les sites Sanofi de Lisieux (Calvados) pour les formes solides, et Compiègne (Oise) pour les formes liquides. Ce sont plus de 1 700 salariés qui œuvrent quotidiennement à son élaboration, dans un cadre pharmaceutique extrêmement normé, sous contrôle de l’ANSM. Aucun changement n’est prévu ni sur le plan galénique, ni sur les volumes produits, ni sur les circuits d’approvisionnement officinaux.
L’entrée de capitaux étrangers : un risque maîtrisé
L’irruption d’un fonds d’investissement américain dans la gouvernance d’un médicament aussi emblématique aurait pu susciter une inquiétude légitime. C’est pourquoi l’opération a été négociée avec l’État français, qui a obtenu des garanties fermes. Un pacte d’actionnaires lie désormais les partenaires, imposant le maintien de la production en France pendant au moins dix ans. Des engagements de maintien d’emploi ont été signés, ainsi qu’un plan d’investissement industriel de 70 millions d’euros sur cinq ans pour moderniser les sites. Enfin, en cas de manquement à ces obligations, des pénalités financières de 100 millions d’euros sont prévues. Ce dispositif vise à éviter tout scénario de délocalisation rampante, tout en accompagnant la croissance internationale d’Opella.
L’industrie pharmaceutique dans une économie mondialisée
À l’échelle mondiale, l’industrie pharmaceutique évolue rapidement. Les grands laboratoires opèrent une spécialisation croissante autour de leurs axes de recherche les plus rentables et innovants. La cession partielle d’activités dites “matures” comme l’automédication n’est pas une exception française : elle reflète une tendance globale. Pour autant, ces produits restent essentiels à la santé publique. C’est pourquoi leur encadrement réglementaire, leur production locale et la transparence de leur gouvernance sont aujourd’hui des sujets centraux. Doliprane, comme d’autres médicaments d’usage courant, ne doit jamais être traité comme un simple produit de consommation. Il doit rester un bien de santé soumis à une vigilance permanente.
Souveraineté pharmaceutique et régulation partagée
L’opération Opella questionne à juste titre la notion de souveraineté pharmaceutique. Mais souveraineté ne signifie pas autarcie. Elle repose sur la capacité à maîtriser la production, la qualité, la distribution et l’accès au médicament. En conservant l’intégralité de la fabrication en France, en assurant la continuité de l’expertise industrielle, et en gardant une présence nationale dans la gouvernance, cette souveraineté est, ici, protégée. Ce modèle de régulation partagée — où l’État, l’industriel et l’investisseur privé agissent de concert — pourrait servir d’exemple dans d’autres segments critiques, notamment les antibiotiques, les anticancéreux génériques ou les vaccins.
Une vigilance professionnelle et institutionnelle à maintenir
Pour les professionnels de santé, notamment les pharmaciens d’officine, cette cession ne modifie ni les protocoles de délivrance, ni les statuts réglementaires, ni les conditions de prescription. Le Doliprane conserve son statut d’OTC, ses codes CIP, ses mentions légales, et sa formulation inchangée. Les officines continueront à le dispenser comme elles le font depuis des décennies, avec la même exigence de qualité et le même devoir de conseil. Toutefois, dans un contexte de mutations industrielles rapides, la profession devra rester vigilante : sur les évolutions de portefeuille, sur la disponibilité, sur le juste prix, et sur l’information des patients.
Une décision industrielle assumée, un produit de santé préservé
La cession de 50 % d’Opella ne signifie pas que Doliprane devient un médicament “américain”. Il demeure une marque française, produite en France, contrôlée par des experts français, et diffusée majoritairement sur le marché français. Il s’agit d’une opération capitalistique, pas d’un transfert de souveraineté. L’essentiel est maintenu : la capacité à soigner, la garantie de qualité, et la permanence de l’accès au traitement. Dans un système de santé où la confiance entre industriels, régulateurs et professionnels est fondamentale, cette opération rappelle que l’indépendance pharmaceutique peut se conjuguer avec l’ouverture, à condition qu’elle soit régulée, transparente, et orientée vers l’intérêt général.
 Se connecter
Se connecter