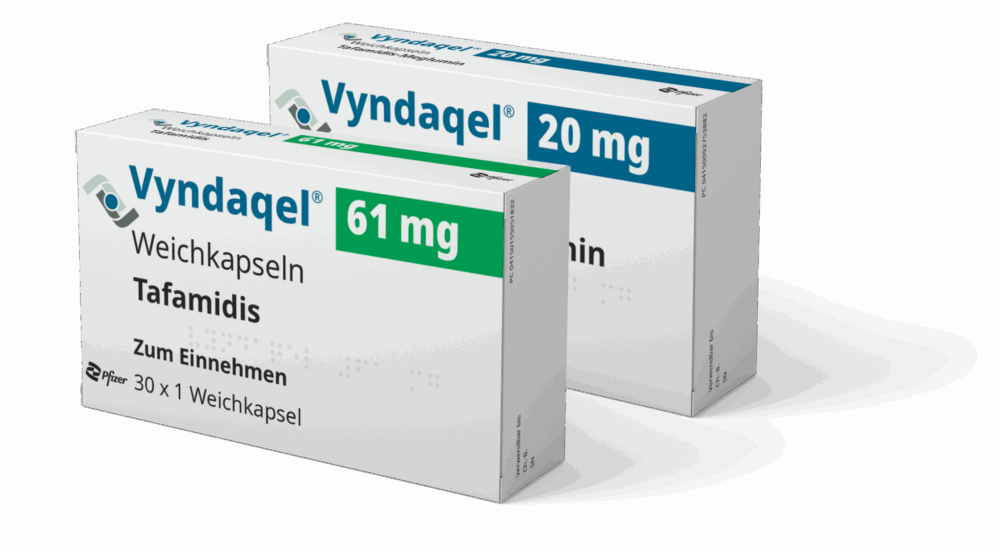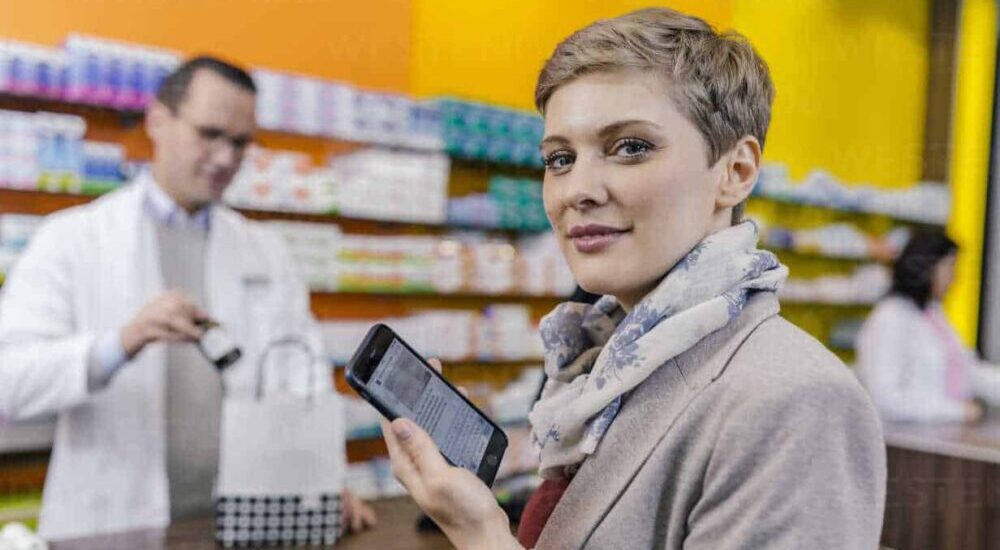Interview exclusive : Fabien Bruno, pharmacien titulaire du préparatoire Delpech à Paris, tire la sonnette d’alarme
Alors que les ruptures de médicaments s'intensifient, les autorités semblent avoir décidé de compliquer davantage le recours aux préparations magistrales, pourtant essentielles à la continuité des soins. Fabien Bruno, titulaire du préparatoire Delpech à Paris, alerte sur une décision administrative récente qu'il juge incompréhensible, dangereuse pour les patients et intenable économiquement. Il appelle les autorités à revenir rapidement à la raison.

La récente décision administrative a été perçue par certains comme un désengagement vis-à-vis des préparations magistrales. Est-ce ainsi que vous l’interprétez aujourd’hui, et pourquoi ?
Fabien BRUNO : Ce que j’ai ressenti, c’est une forme d’abandon, mais aussi d’incompréhension complète de notre métier. Lors de la réunion, j’ai perçu une confusion inquiétante entre deux situations bien distinctes : d’une part, le cas où l’ANSM émet une recommandation officielle permettant aux pharmaciens de substituer une spécialité par une préparation sans avoir besoin d’une ordonnance conforme, et d’autre part, le cas — plus classique mais tout aussi légitime — où un médecin rédige une ordonnance de préparation magistrale spécifique en cas de rupture. Dans cette seconde situation, il est évident que la préparation doit être remboursée. Pourtant, les autorités ne semblaient pas saisir la différence, comme si tout était mis dans le même sac. Cette absence de discernement est profondément problématique.
Comment expliquer un tel flou dans une réunion pourtant composée d’acteurs clés comme la DGS ou la DSS ?
F. B. : C’est exactement la question qu’on se pose. On parle ici de hauts représentants de la santé publique — DGS, DSS, CNAM — mais l’ANSM, pourtant centrale dans ce sujet, n’était pas présente. Ce que j’ai entendu, ce sont des arguments juridiques répétés à l’envi : « Nos services juridiques ont analysé les textes, et la position est claire. »
Sauf que cette position ne tenait pas compte de la réalité du terrain, ni de la complexité des situations.
Aucun effort de clarification, aucune capacité à faire la distinction entre les cas. Même les représentants syndicaux, comme Pierre-Olivier Variot, ont tenté d’obtenir des précisions… sans succès. Et depuis, toujours pas de compte rendu officiel. On est dans le flou total.
Est-ce une tentative déguisée de faire des économies ?
F. B. : Si c’est le cas, c’est totalement contre-productif. Ce qui est en jeu avec la sertraline, ce sont 10 000 patients environ, à raison de 20 euros la préparation magistrale. Cela représente 200 000 euros. À l’échelle du budget de l’Assurance maladie, c’est dérisoire. Et surtout, on oublie le coût réel d’une rupture de traitement : une hospitalisation en psychiatrie, ce sont des milliers d’euros, des semaines de soins, sans compter les conséquences sociales, humaines, familiales. Ce genre d’économie, c’est de la politique à très court terme. Un traitement qui coûte 20 euros peut éviter des hospitalisations à 10 000. Il faut remettre les choses dans leur contexte.
Que répondez-vous aux critiques sur le coût élevé des préparations magistrales ?
F. B. : Le coût est relatif. Oui, une préparation peut coûter 23 euros. Mais, regardez combien coûte la spécialité : parfois 2 euros pour le cas de l’amoxicilline.
Ce n’est pas la préparation qui est trop chère, c’est la spécialité qui est sous-évaluée.
En Suisse, l’amoxicilline est vendue autour de 18 euros. À ce tarif-là, la fabrication reste viable pour les industriels. En France, à 2 euros, nous ne sommes pas une priorité en cas de tension mondiale. Et puis dans ces 23 euros, il faut intégrer la main-d’œuvre — 9,50 euros dès le départ — les matières premières, le conditionnement, les contrôles. Ce n’est pas une marge démesurée. En réalité, la préparation est à peine rentable pour le pharmacien. Ce qu’il faut revoir, c’est l’échelle des prix des spécialités, pas pointer du doigt les préparateurs.
Quel est l’impact immédiat de cette situation sur votre préparatoire ?
F. B. : Il est immense.
Nous avions anticipé la pénurie de sertraline en achetant 40 kg de matière première, soit environ 40 000 euros d’investissement. Si rien n’est remboursé, cette matière est perdue.
C’est une perte sèche. Et forcément, à l’avenir, nous deviendrons beaucoup plus prudents. Sauf que cette prudence va nous faire perdre notre réactivité. Aujourd’hui, la force du préparatoire, c’est d’agir vite : on commence à produire dès que la rupture est avérée, et on arrête aussi vite si la spécialité revient. Mais, si on doit attendre l’ANSM, puis l’arrêté de prix, puis la livraison de la matière, puis les validations… on parle de plusieurs semaines. C’est totalement incohérent avec l’esprit même de la préparation magistrale.
Les autorités vous ont-elles apporté un quelconque soutien depuis cette réunion ?
F. B. : Nous avons eu des appels informels de certains services du ministère, disant qu’ils feraient « tout leur possible ». Mais, à ce jour, rien de concret, ni de public. Tout le monde semble embêté par la position de la DSS, y compris en interne. Ce flou, ce silence, cette absence de suivi officiel, c’est très pesant pour les professionnels de terrain. On a le sentiment d’un désintérêt, voire d’un mépris latent.
Et les prescripteurs, comment réagissent-ils à cette crise ?
F. B. : Ils sont totalement abasourdis. J’ai publié sur LinkedIn un podcast avec un psychiatre, qui explique son incompréhension face à la situation. Les médecins sont démunis. On leur dit que la sertraline est en rupture, qu’ils peuvent prescrire une préparation magistrale, mais que celle-ci ne sera pas remboursée. C’est absurde. On parle de patients fragiles, parfois instables, qui ont besoin de continuité. Et on leur oppose un mur administratif. Tout cela, en pleine année de la psychiatrie… C’est un contresens dramatique.
Envisagez-vous des recours juridiques en cas de refus de remboursement ?
F. B. :. Clairement. Si des indus sont émis sur des préparations réalisées sur ordonnance conforme, nous irons au tribunal administratif. Et nous sommes confiants. Nous avons déjà saisi des avocats, les syndicats sont mobilisés. Ce n’est pas une question de bonne volonté, c’est une question de droit. Nous ne parlons pas ici de substitution non encadrée, mais de prescriptions rigoureuses, en bonne et due forme. Ce que nous demandons, c’est que le droit soit respecté. Si la DSS persiste, ce sera à la justice de trancher.
Que faudrait-il faire immédiatement pour résoudre cette crise ?
F. B. : Il faut trois choses très simples. D’abord, que toute préparation magistrale réalisée en cas de rupture, sur prescription conforme, soit remboursée si la spécialité de référence l’est aussi. Ensuite, que la recommandation de l’ANSM retrouve sa fonction première : informer, orienter, guider. Elle n’a pas vocation à conditionner un remboursement. Enfin, que les autorités appliquent la réglementation actuelle, qui interdit de préparer un médicament si la spécialité est disponible. Dire qu’il n’y a pas de rupture tout en nous autorisant à faire une préparation non remboursée, c’est juridiquement incohérent.
Vous évoquez une dérive vers une médecine à deux vitesses ?
F. B. : Oui, et c’est très grave. Le message sous-jacent, c’est : « Faites la préparation, mais si le patient ne peut pas payer, tant pis pour lui. » C’est le retour d’une médecine où seuls les plus aisés peuvent accéder au traitement. On nous dit que ce sont de « petites économies » pour la Sécurité sociale, mais en réalité, c’est un choix de société. En France, on a toujours dit que les soins devaient être égaux pour tous, quel que soit le revenu.
Ce n’est pas à la DSS de décider de casser ce principe.
S’il faut débattre d’une médecine à deux vitesses, qu’on le fasse au Parlement. Mais, qu’on ne le fasse pas en douce, par voie administrative.
Un dernier message à adresser aux autorités ?
F. B. : Je leur demande de revenir à la raison. Ce flou juridique, cette incompréhension des réalités du terrain, cette stratégie de petites économies… tout cela est indigne. Le préparatoire, c’est un maillon vital de la chaîne de soin. Si on casse cette capacité de réaction, on met en danger la santé de milliers de patients. On espère encore un revirement, une clarification, une prise de conscience. Mais, s’il le faut, on ira jusqu’au bout pour défendre notre métier, notre éthique, et nos patients.
 Se connecter
Se connecter