Affection hivernale : l'officine première ligne de la prévention
Chaque hiver, nos comptoirs deviennent la première ligne face au déferlement viral : grippe, Covid-19, bronchiolite à VRS, gastro-entérites, rhinopharyngites. Derrière ces syndromes apparemment banals se cachent des millions de consultations, des milliers d'hospitalisations et un poids sanitaire majeur pour les publics vulnérables. En tant que pharmaciens, nous avons une responsabilité centrale : vacciner tôt, conseiller juste, dépister les signaux de gravité et sécuriser les parcours de soins. Dans ce Grand Angle, nous passons en revue les réflexes essentiels à adopter pour prévenir, accompagner et protéger efficacement nos patients tout au long de la saison hivernale.

L’hiver : un terrain infectieux
Une tension virale
Chaque hiver, un faisceau de virus respiratoires et digestifs met sous tension cabinets et officines : grippe et Covid en tête, virus respiratoire syncytial (VRS) à l’origine des bronchiolites, norovirus et rotavirus pour les gastro-entérites, sans oublier les rhinopharyngites qui saturent la pédiatrie.
Les chiffres restent lourds : environ 21 millions de gastro-entérites par saison, dont près de 4 millions de consultations ; une bronchiolite qui touche un nourrisson sur trois avant 2 ans (400 000 cas, près de 30 000 hospitalisations) ; une grippe responsable de 2 à 6 millions de cas symptomatiques et de 8 000 à 10 000 décès lors des hivers sévères. Depuis 2023, le Covid-19 suit un profil saisonnier comparable à la grippe, concentrant ses formes graves chez les plus de 65 ans et les polypathologiques.
Des populations vulnérables
Les publics à risque sont clairement identifiés : nourrissons, femmes enceintes, seniors, patients atteints de BPCO, d’insuffisance cardiaque ou rénale, de diabète, de cancer ou d’immunodépression.
L’hiver 2025-26 renforce la prévention ciblée : campagnes vaccinales grippe et Covid toujours prioritaires, mais également innovations majeures dans la lutte contre le VRS avec :
Beyfortus® chez le nourrisson de moins de 1 an : 50 mg si poids corporel < 5 kg ; 100 mg si poids corporel ≥5 kg.
Abrysvo® chez la femme enceinte entre 32 et 36 semaines d’aménorrhées et chez les plus de 60 ans.

L’officine, pivot de la prévention
Dans ce paysage viral dense, l’officine s’impose comme un maillon essentiel de la santé publique. Nous vaccinons (grippe, Covid, VRS selon les indications), nous cadrons le conseil symptomatique, nous rappelons les mesures d’hygiène, et nous savons détecter et réorienter face aux signaux d’alerte.
L’hiver n’est plus seulement une période d’activité intense : c’est la saison où notre clinique de proximité fait la différence, en évitant les consultations inutiles, en sécurisant les plus fragiles et en contribuant à désengorger les urgences et la médecine de ville.
L’arsenal vaccinal
Grippe et Covid-19
Pour l’hiver 2025-26, la prévention face à la grippe sur des vaccins trivalents : Vaxigrip®, Influvac® et Flucelvax® (culture cellulaire sans protéines d’œuf).
Chez les plus de 65 ans, la HAS recommande en priorité Efluelda® ou Fluad® pour compenser l’immunosénescence.
Côté Covid-19, le virus suit désormais un profil saisonnier : le rappel automnal s’appuie sur un vaccin monovalent de Pfizer : Comirnaty® LP 8.1.
Les cibles principales perdurent : seniors, immunodéprimés, patients avec comorbidités, femmes enceintes, entourage des fragiles et professionnels exposés, avec un message clé au comptoir : « Faites le rappel d’automne dès que possible ! ».
La co-administration grippe/Covid est recommandée le même jour : deux sites distincts, sans intervalle minimal (et aucun délai requis si non concomitante).
En pratique : vérifier les contre-indications, privilégier Efluelda® ou Fluad® chez les plus de 65 ans, et proposer une seule séance pour deux vaccinations.
Protéger sans délai
Aucune étude n’a montré qu’attendre améliore la protection : l’immunité conférée couvre l’ensemble de la saison épidémique. Au contraire, retarder expose à rester vulnérable pendant les premières vagues. Rappelons qu’il faut environ 15 jours après l’injection pour obtenir une protection anticorps efficace. Le bon réflexe à transmettre : se faire vacciner dès le lancement de la campagne, pour être protégé avant les premiers cas et sécuriser la période hivernale.
L’arsenal thérapeutique
Les antiviraux
Côté grippe, l’oseltamivir reste le seul antiviral utilisable en ville. Son efficacité est modeste, mais démontrée lorsqu’il est prescrit dans les 48 heures après le début des symptômes, et réservé aux patients à risque de complications ou aux formes graves orientées à l’hôpital. À l’officine, notre rôle est d’orienter rapidement pour permettre une prescription précoce : au-delà de ce délai, le bénéfice disparaît.
Depuis mars 2025, la délivrance de Paxlovid® en officine n’est plus soumise au régime de dispensation conditionnelle. Toutefois, elle doit s’accompagner d’un criblage rigoureux des IM (le ritonavir étant un inhibiteur puissant du CYP3A4), et une évaluation de la fonction rénale et hépatique.
Quant à l’amantadine (Mantadix®), elle n’a plus aucune indication en grippe en raison de résistances quasi universelles.
L’amantadine conserve une AMM dans la grippe A, mais son usage est théorique. Les résistances massives (>90 % des souches A), son inefficacité sur la grippe B et ses effets indésirables neurologiques et cardiovasculaires ont conduit la HAS, l’OMS et le CDC à ne plus la recommander.
Les antipyrétiques
Chez un patient grippé : le paracétamol reste la référence (15 mg/kg/prise, intervalle minimal 6 heures, maximum 60 mg/kg/j), avec vigilance accrue en cas d’atteinte hépatique ou de consommation chronique d’alcool, et contrôle systématique du cumul de spécialités pour éviter le surdosage (première cause d’hépatite médicamenteuse aiguë en France).
À l’inverse, les AINS ne doivent pas être utilisés en systématique dans la grippe, l’angine ou la varicelle : leur effet antipyrétique est équivalent au paracétamol, mais ils ont été associés à des complications infectieuses et peuvent masquer des signes de gravité.
Autres conseils clés
La réussite du traitement ne se limite pas aux médicaments : le repos, impliquant un arrêt temporaire des activités professionnelles et sociales, et une hydratation abondante sont essentiels. La fièvre accroît les pertes hydriques et expose rapidement les personnes âgées à la déshydratation et à la confusion. Quant à l’asthénie post-grippale, aucun médicament ne peut la corriger : seule une période de récupération suffisante permet de réduire la durée et l’intensité des symptômes.
Bronchiolite
La bronchiolite est l’infection virale la plus redoutée de l’hiver pédiatrique. Elle touche près d’un nourrisson sur trois avant l’âge de 2 ans, avec environ 460 000 cas par an en France et jusqu’à 30 000 hospitalisations chaque saison. Le VRS est responsable de plus de 70 % des cas. Les formes graves se concentrent chez les moins de six mois, les prématurés, les nourrissons porteurs de cardiopathies congénitales, de dysplasies broncho-pulmonaires ou d’immunodépressions. Pour ces publics, l’hospitalisation peut se compliquer de détresse respiratoire aiguë, d’apnées ou d’hypoxémies sévères. Face à cette lourde charge épidémiologique et à l’absence de traitement curatif, la prévention prend désormais une place centrale. Depuis 2023, deux stratégies de prévention ont transformé la donne :
- Beyfortus® (Sanofi) est un anticorps monoclonal à longue durée d’action, indiqué pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au VRS chez tous les nouveau-nés et nourrissons entrant dans leur première saison de circulation du virus, y compris ceux nés à terme et en bonne santé. Administré en dose unique intramusculaire, à la maternité ou dans les premières semaines de vie, il assure une protection d’environ cinq mois, couvrant toute la saison épidémique. Il peut également être proposé jusqu’à 24 mois chez les enfants demeurant vulnérables à une forme sévère du VRS (prématurité, cardiopathie congénitale, immunodépression).
- Abrysvo® (Pfizer) est un vaccin bivalent à base de protéines F pré-fusion stabilisées, ciblant les souches A et B du virus respiratoire syncytial (VRS). Administré chez la femme enceinte entre 24 et 36 SA, il induit une immunité transplacentaire qui protège le nourrisson dès la naissance, réduisant nettement les hospitalisations liées au VRS.
Il est également indiqué chez les adultes de 60 ans et plus, particulièrement exposés aux formes sévères et aux exacerbations respiratoires (BPCO, insuffisance cardiaque, pneumopathies).
Utiliser du sérum physiologique pour laver le nez plusieurs fois par jour.
Surveiller attentivement la respiration (fréquence, tirage, pauses) et l’alimentation (quantité bue, refus du biberon).
Consulter sans délai si l’enfant présente une gêne respiratoire marquée, des apnées, une cyanose ou refuse de s’alimenter.
Recourir à la kinésithérapie respiratoire avec clapping/AFE en dehors d’indications hospitalières.
Utiliser des aérosols de bronchodilatateurs ou de sérum hypertonique, sans efficacité prouvée en ville.
Les sirops fluidifiants ou antitussifs, CI chez le nourrisson.
Gastro-entérite
Hydratation, pierre angulaire
Chaque hiver, les gastro-entérites virales touchent toutes les classes d’âge, avec une prédominance du norovirus et du rotavirus chez le nourrisson. Le risque majeur demeure la déshydratation, particulièrement chez le nourrisson et le sujet âgé. La prise en charge repose d’abord sur l’administration précoce d’une solution de réhydratation orale (SRO), seule option validée pour compenser efficacement les pertes hydro-électrolytiques. Les boissons sucrées, sodas, bouillons déséquilibrés ou préparations maison sont inadaptés et peuvent aggraver l’état du patient.
Repérage des signes de déshydratation
- Chez le nourrisson : fontanelle déprimée, absence de larmes, couches peu mouillées, agitation suivie de somnolence.
- Chez le sujet âgé : soif intense, muqueuses sèches, pli cutané persistant, hypotension, confusion.
Tout doute impose une réorientation médicale rapide.
Antidiarrhéiques : hiérarchiser les options
Le lopéramide, encore largement utilisé, est contre-indiqué avant deux ans, déconseillé chez le nourrisson et inadapté dans les diarrhées infectieuses, son action ralentissant le transit et favorisant les complications (iléus, mégacôlon toxique). Le racécadotril, inhibiteur de l’enképhalinase à effet antisécrétoire, réduit les pertes hydriques sans ralentir le transit. Il est indiqué dès trois mois, avec une tolérance supérieure, et constitue l’antidiarrhéique de référence en relais du SRO.
Probiotiques et levures : place raisonnée
Les résultats cliniques restent hétérogènes. Certaines souches comme Saccharomyces boulardii et Lactobacillus rhamnosus GG montrent une réduction modeste de la durée des diarrhées si elles sont introduites précocement, toujours en complément du SRO. En officine, on retrouve, par exemple, Ergyphilus® Confort (Nutergia) ou Lactibiane® Imedia (PiLeJe).
À noter : S. boulardii est contre-indiquée chez l’immunodéprimé, le porteur de cathéter et le patient en réanimation, où des infections opportunistes ont été rapportées.
Infections ORL : des conseils à sécuriser
Rappeler les durées physiologiques
En hiver, rhume, rhinopharyngite, sinusite virale, angine et otite constituent le quotidien du comptoir. Dans ces pathologies le plus souvent virales, notre rôle est de rappeler systématiquement les temps d’évolution physiologiques : une rhinopharyngite guérit spontanément en 7 à 10 jours ; une sinusite virale simple se résout en moins de deux semaines ; une toux post-infectieuse, liée à l’hyperréactivité bronchique résiduelle, peut persister jusqu’à trois semaines sans complication. L’angine virale se traduit par une fièvre et une odynophagie qui régressent en quelques jours, alors que l’otite séreuse peut mettre plusieurs semaines à s’assécher sans antibiothérapie. Ces repères, validés par les sociétés savantes, sont essentiels : ils permettent de prévenir la surmédicalisation, d’éviter des traitements inadaptés (antibiotiques injustifiés, corticoïdes inappropriés, vasoconstricteurs dangereux), et de soutenir un discours pédagogique solide face à des patients souvent pressés de guérir vite.
Médicaments à risque
Vasoconstricteurs oraux
Depuis le 11 décembre 2024, toutes les spécialités à base de pseudoéphédrine sont soumises à prescription obligatoire après les signalements d’AVC ischémiques ou hémorragiques, de syndromes PRES/RCVS (maux de tête soudains et sévères ou des céphalées en coup de tonnerre, des nausées, des vomissements, de la confusion, des convulsions ou des troubles visuels) et d’accidents cardiovasculaires graves. Leur intérêt clinique étant minime, ils n’ont plus leur place en automédication.
Vasoconstricteur nasal
Quelques sprays persistent à l’ordonnance, comme la naphazoline (Derinox®) et l’oxymétazoline (Aturgyl® ou Pernazène®). Leur efficacité reste limitée, tandis que les risques cardiovasculaires et neurologiques (troubles du rythme, poussées hypertensives, AVC, colites ischémiques) sont bien documentés. Prescrire les cite parmi les médicaments à écarter, et l’ANSM rappelle un usage strict : pas plus de cinq jours, jamais en association, et réservé à l’adulte sans comorbidité.
En pratique, le lavage nasal reste la mesure de référence, sûre et efficace à tout âge. Les solutions isotoniques peuvent être utilisées quotidiennement, et les hypertoniques lors d’épisodes congestifs courts. L’étude observationnelle Narhinel a montré une réduction significative des récidives d’otites et de rhinites infectieuses chez les enfants utilisant régulièrement la combinaison mouche-bébé + solution saline physiologique.
Comme le rappelle Valérie Michaud, Docteur en Pharmacie et Responsable des Affaires Médicales France chez Haleon, « le lavage nasal constitue une mesure simple, non médicamenteuse et bien tolérée, qui aide à prévenir les complications ORL virales chez le nourrisson et l’enfant, à condition d’un geste doux, répété et bien enseigné ».
Anti-H1 1re génération
Dépourvus d’efficacité dans le rhume, ils exposent à une sédation, une confusion et des effets anticholinergiques (sécheresse buccale, rétention urinaire, constipation), particulièrement problématiques chez les personnes âgées. Là encore, Prescrire les cite régulièrement parmi les médicaments « à écarter » en automédication.
Antitussifs
La codéine est proscrite chez les moins de 12 ans et sur ordonnance ; le dextrométhorphane est soumis à prescription depuis 2017, tout comme l’éthylmorphine (Tussipax®) et la noscapine (Tussisedal®) ; la pholcodine (Biocalyptol®) a été retirée du marché en 2023 (risque d’anaphylaxie avec les curares).
L’oxomémazine doit rester un appoint ponctuel chez l’adulte pour des toux sèches invalidantes. Le message clé reste : la toux est un réflexe de défense, il s’agit de la moduler, pas de la supprimer.
TROD angine
Depuis 2024, le TROD angine peut être réalisé en officine chez l’adulte et l’enfant à partir de 10 ans, à condition d’avoir suivi la formation certifiante obligatoire. La sélection des patients repose sur le score de McIsaac (voir ci-contre), qui évalue la probabilité d’une infection à streptocoque du groupe A (SGA).
Symptômes :
Fièvre > 38 °C = + 1 ; Absence de toux = + 1 ; Adénopathie cervicale sensible = + 1 ; Amygdales rouges ou pultacées = + 1
Âge :
3-14 ans = + 1, 15-44 ans = 0, ≥ 45 ans = -1.
Résultats :
0-1 point : probabilité faible -> pas de TROD ; ≥ 2 indication du TROD.
En cas de TROD positif, nous pouvons désormais prescrire un antibiotique, sauf en présence de critères d’exclusion (terrain fragile, récidives, antécédents allergiques complexes, complications).
L’amoxicilline demeure le traitement de première intention : 2 g/j en deux prises chez l’adulte, selon un schéma adapté au poids chez l’enfant, pour une durée de 6 jours.
En cas d’allergie aux pénicillines, une céphalosporine orale de 2ᵉ génération (céfuroxime axétil ou céfpodoxime proxétil) peut être prescrite sur 4 à 5 jours.
Les macrolides doivent être réservés aux situations exceptionnelles, compte tenu du taux élevé de résistances observé.
Enfin, si le TROD est négatif, l’origine virale de l’angine est confirmée : aucun antibiotique n’est alors justifié, et la prise en charge repose sur le traitement symptomatique.
Conseils symptomatiques validés
Le lavage nasal est central. Il désencombre mécaniquement les fosses nasales, élimine virus, allergènes et mucosités, et favorise la régénération de la muqueuse. Les solutions d’eau de mer hyper- ou isotoniques offrent un avantage sur le sérum physiologique par leur richesse en minéraux, qui renforce l’effet osmotique et décongestionnant. Certaines formules enrichies apportent un bénéfice additionnel, comme Stérimar® Cuivre, dont l’oligo-élément est mis en avant pour ses propriétés protectrices locales. D’autres spécialités, comme Actisoufre®, à base de soufre et de levures, sont indiquées dans les états inflammatoires chroniques ORL et respiratoires, en modulant la flore nasopharyngée et en soutenant les terrains récidivants.
Les données cliniques confirment cette utilité : l’utilisation d’un lavage nasal avec solution saline hypertonique associé à des gargarismes réduit la durée des symptômes du rhume d’environ deux jours et limitait la transmission intrafamiliale.
En pratique, il faut insister sur la bonne technique (tête légèrement inclinée, fréquence 3 à 6 fois/jour selon l’encombrement) et la régularité du geste. Même si les solutions enrichies peuvent apporter un plus, c’est avant tout la rigueur du lavage qui conditionne l’efficacité clinique.
Signes d’alerte : ne pas banaliser
Certains signaux imposent une réorientation médicale immédiate :
- fièvre élevée persistante,
- aggravation secondaire après amélioration initiale,
- symptômes > 7-10 jours,
ou présence d’un terrain fragile (nourrisson, sujet âgé, immunodéprimé, patient avec BPCO, insuffisance cardiaque, diabète ou insuffisance rénale).
Ils peuvent traduire une complication bactérienne (sinusite purulente, otite moyenne aiguë, pneumonie) nécessitant une prise en charge médicale rapide.
Phytothérapie et aromathérapie
L’hiver reste une saison privilégiée pour les solutions naturelles, mais elles exigent un conseil rigoureux. Plantes, extraits et huiles essentielles ne sont ni anodins ni interchangeables : chacun a ses atouts, ses limites et ses précautions. À nous de sécuriser leur usage, en les intégrant dans une stratégie de prise en charge globale.
Renforcer les défenses
La demande de « renforcement » est quasi systématique dès l’automne. Les multivitaminés enrichis en oligo-éléments gardent toute leur pertinence : AZINC® Immunité (Arkopharma) couvre les besoins en vitamines A, C, D, E et groupe B, associés au zinc, sélénium et cuivre.

Oscillo’Immunité® (Boiron) va plus loin en combinant vitamine D, zinc, sélénium, β-glucanes et sureau noir, dans une approche immunomodulatrice documentée. Immunomix® (Aboca) repose sur l’échinacée, le sureau, l’éleuthérocoque et le gingembre, un cocktail de plantes traditionnellement mobilisées pour stimuler les défenses. Enfin, Ergyphilus® Défense (Nutergia) mise sur une stratégie originale : 7 souches probiotiques dosées à 8 milliards/gélule, enrichies en vitamine C, pour soutenir à la fois le microbiote et l’immunité muqueuse.
Complément jour & nuit
Les affections hivernales bénignes, le plus souvent d’origine virale, s’accompagnent d’une inflammation des voies respiratoires supérieures et d’une réponse immunitaire accrue. Si le traitement reste symptomatique, certaines associations de plantes et d’huiles essentielles peuvent soutenir la résistance de l’organisme et améliorer le confort respiratoire.
Aromaforce Coups de Froid Jour/Nuit (Pranarôm) repose sur une approche chrono-phytothérapeutique : deux formules distinctes, adaptées aux besoins du jour et de la nuit.
La formule Jour combine les huiles essentielles de ravintsara (Cinnamomum camphora CT cinéole), menthe poivrée, eucalyptus globuleux, pin sylvestre, romarin à cinéole, grande camomille et galanga. Ces actifs à propriétés antivirales, expectorantes et tonifiantes contribuent à dégager les voies respiratoires et à soutenir la vitalité.
La formule Nuit associe lavande vraie, menthe verte et bétaïne issue du thé vert, pour favoriser un sommeil réparateur et un confort respiratoire nocturne.
L’intérêt du dispositif réside dans la complémentarité jour/nuit, permettant une action continue, respectueuse du rythme biologique.

De son côté, Efirub Coups de Froid (Les 3 Chênes) s’appuie sur une synergie de plantes et de vitamines : échinacée, sureau noir, thym et gingembre, associés aux vitamines C et D ainsi qu’à des huiles essentielles d’eucalyptus et de ravintsara. Cette combinaison contribue à stimuler les défenses immunitaires, protéger les muqueuses respiratoires et réduire la sensation de malaise liée aux refroidissements passagers.

Gorge irritée
Les irritations pharyngées sont le lot commun des pathologies hivernales. L’association de plantes adoucissantes et de zinc, comme dans les pastilles Azéol® (PiLeJe), soulage rapidement. Les formules à base de propolis apportent une dimension barrière : Propolgemma® (Aboca), en spray ou comprimés, associe résines et polysaccharides pour former un film protecteur, tandis que Salvigorge 2Act® (Aboca) complète l’arsenal avec une action apaisante ciblée.
Toux et bronches
Pour calmer une toux sèche, l’intérêt des extraits de thym, plantain et guimauve est bien établi, comme dans Azéol® Sirop Toux Sèche (PiLeJe). Quand l’expectoration doit être facilitée, l’association grindélia + thym + eucalyptus radiata d’Azéol® Voies Respiratoires soutient le drainage bronchique.

En première intention chez l’enfant, Grintuss® (Aboca) reste une valeur sûre : dispositif médical à base de grindélia, plantain, hélichryse et miel, il agit comme film protecteur qui module la toux, sèche ou grasse, dès un an.
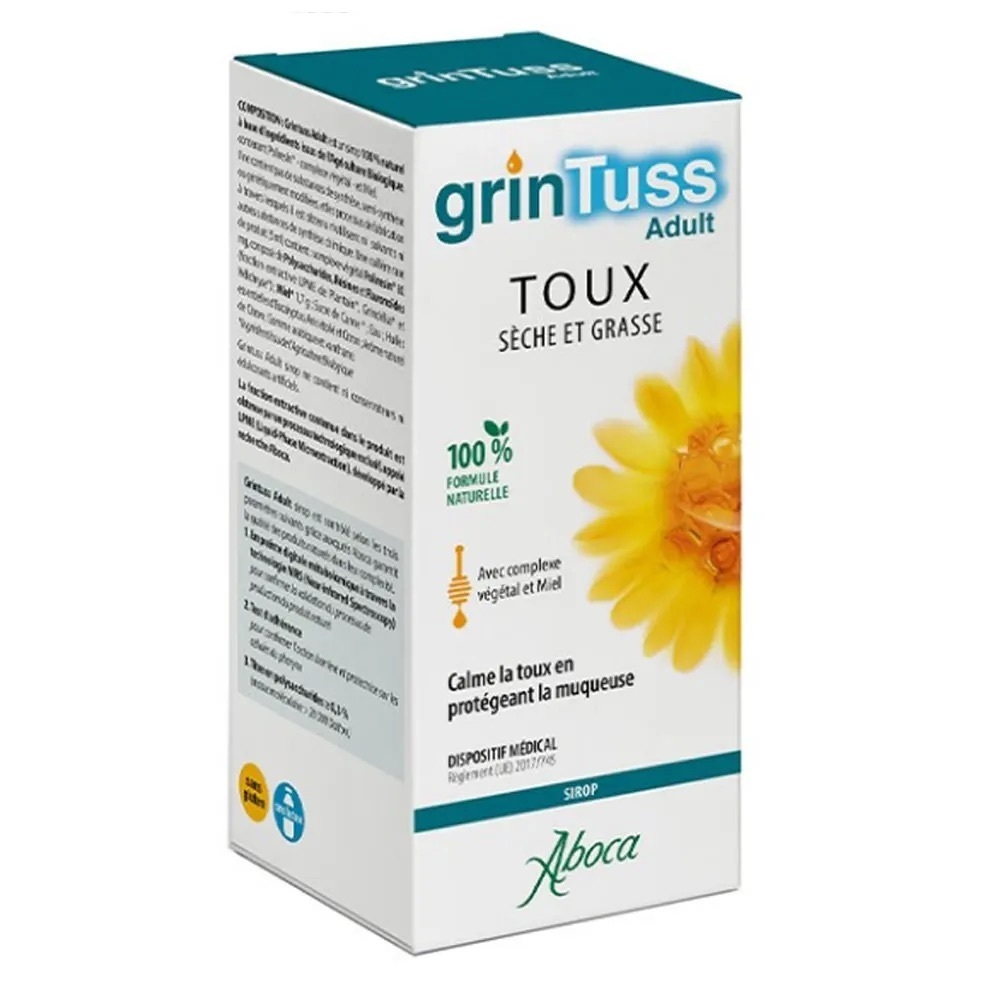
Aromathérapie et sinus
En cas de rhinite ou sinusite, les huiles essentielles comme l’eucalyptus radiata, le ravintsara ou le tea tree démontrent leur intérêt : fluidification des sécrétions, action antivirale et antibactérienne documentée. Mais, leur usage impose un cadre strict : dilution systématique, contre-indications formelles chez l’enfant, la femme enceinte et l’épileptique, et exclusion des HE riches en cétones terpéniques (sauge officinale, thuya, romarin à verbénone). Leur efficacité se gagne au prix d’une vigilance constante.
Sécurité : jamais optionnelle
La naturalité ne signifie pas innocuité. Certaines plantes demandent la même vigilance que les médicaments classiques. La réglisse peut élever la tension artérielle et favoriser la rétention d’eau et de sodium, ce qui la contre-indique en cas d’hypertension ou d’insuffisance cardiaque. Le saule blanc, riche en dérivés salicylés, majore le risque hémorragique chez les patients sous anticoagulants ou allergiques à l’aspirine. L’échinacée est déconseillée en cas de maladie auto-immune. Quant aux huiles essentielles, elles doivent être strictement dosées, bien diluées et réservées à un usage approprié à l’âge et à la sensibilité cutanée.
*Source : Yusuf et al. (2024)
 Se connecter
Se connecter

